Écouter le podcast en entier :
Par Abdeslam Seddiki
Après chaque crise, on nous promet des changements de paradigme et d’orientation et que la situation ne sera plus comme avant. Ainsi, lors de la crise covid, la question de l’indépendance économique revenait comme un leitmotiv. Il était question de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, de souveraineté sanitaire…
Intéressons-nous à la question de souveraineté alimentaire et posons-nous la question suivante : est-elle compatible avec les orientations du plan Maroc Vert et du plan «Génération Green » qui lui a succédé ? Nous répondons d’emblée par la négative et nous en expliquons les raisons. D’ailleurs, ce plan Maroc Vert est décrié de toutes parts. Même ceux qui étaient auparavant réticents se sont rendus à l’évidence que ce plan a été à l’origine du déséquilibre que connait le marché des produits agricoles, ne serait-ce qu’en privilégiant l’export sur l’approvisionnement du marché local.
Ce qui est demandé aujourd’hui, c’est de revoir notre modèle de développement d’une façon générale et le modèle agro-exportateur à l’œuvre depuis les années quatre-vingts du siècle dernier. Ce modèle s’inscrit dans la logique du libre-échange et de loi ricardienne des avantages comparatifs. Selon cette théorie, largement critiquée par ailleurs, un pays aurait intérêt à produire des biens dans lesquels il dispose d’un avantage et les échanger contre des biens dans lesquels il est relativement désavantagé. On ne se pose nullement la question de l’indépendance économique et de la nécessité d’assurer la souveraineté alimentaire ou autres.
Bien sûr, ce choix n’est pas né ex-nihilo. Il est le produit d’une histoire mouvementée du Maroc post-colonial qui a commencé dès le début des années soixante avec la récupération des terres de la colonisation qui ont été spoliées aux paysans marocains. Contre toute attente, ces terres récupérées (autour d’un million d’hectares), situées dans les plaines fertiles du pays et dont une partie irriguée, n’ont pas été remises intégralement à leurs anciens propriétaires/exploitants dans le cadre d’une réforme agraire, mais elles ont été mises sous la tutelle de l’Etat et exploitées par deux entreprises publiques, SODEA et SOGETA. Une partie non négligeable est passée, par des moyens discutables, entre les mains des gros propriétaires marocains.
Par la suite, l’Etat s’est débarrassé de ce capital foncier public au profit des personnes influentes politiquement et socialement, à travers un système de location de longue durée moyennant des montants symboliques.
Ce processus a conduit à l’émergence d’une classe de capitalistes agraires qui détient les terres les plus fertiles du pays et situées dans les zones irriguées. Une classe réduite en nombre, mais suffisamment forte en influence pour infléchir les politiques publiques et peser sur les choix de développement en s’appuyant sur ses ramifications dans l’administration et les centres de décision.
Une partie non négligeable de cette nouvelle classe capitalise dans l’agriculture n’est pas uniquement d’origine rurale, mais elle est issue également des rangs de la « bourgeoisie bureaucratique » citadine et de la « bourgeoisie affairiste » exerçant dans les activités spéculatives et rentières. Elle s’est servie des largesses de l’administration sous forme d’exonérations fiscales, de subventions à tout va y compris l’utilisation de l’eau d’irrigation quasi-gratuit, d’une main d’œuvre exploitable et corvéable à merci. Il a fallu des années de combat pour imposer l’élargissement de la sécurité sociale à l’agriculture, des décennies de luttes et de revendications pour appliquer l’alignement du SMAG (salaire minimum dans l’agriculture fixé à la journée) sur le SMIG.
Un accord social, signé dans ce sens en 2011, est resté lettre morte. Ce n’est que lors de l’accord social d’avril 2022 qu’une augmentation de 10% du SMAG fut décidée en perspective de l’alignement définitif en 2028 ! En fin de compte, cette bourgeoisie agraire a eu le beurre et l’argent du beurre.
Ce choix est celui du développement de l’agriculture paysanne qui mobilise les forces vives de notre paysannerie riche, faut-il le souligner, d’une histoire millénaire et d’un génie créateur. Ce choix serait à même de garantir notre sécurité alimentaire et d’assurer au pays un mieux vivre en réduisant la pauvreté et en améliorant le cadre de vie de nos campagnes.
Il va sans dire qu’un tel choix a nécessairement des exigences. Il nécessite la définition d’une politique de développement rural axé sur l’inclusivité et la mobilisation populaire en s’appuyant sur le savoir-faire acquis au fil des années par le paysan marocain. Ce modèle a l’avantage d’assurer une agriculture durable, peu consommatrice d’intrants et économe en matière d’eaux. Il assure un meilleur équilibre entre l’homme et la nature, plus de justice sociale. Il est fortement créateur d’emplois et de valeur ajoutée, sans perdre de vue ses impacts multiples sur la santé du citoyen.
En plaidant pour le développement de l’agriculture paysanne et solidaire, il n’est pas dans notre intention de condamner tout recours à l’agriculture capitaliste et à l’exportation de nos produits agro-alimentaires. Le tout doit s’inscrire dans un modèle de développement équilibré et orienté en priorité vers la satisfaction des besoins de la population. En somme, les deux secteurs, les deux piliers pour reprendre la terminologie du PMV, doivent évoluer en parfaite symbiose avec une affectation équitable et démocratique des ressources disponibles. Ce qui est loin d’être le cas pour le moment.
Rédigé par Abdeslam Seddiki












 L'accueil
L'accueil



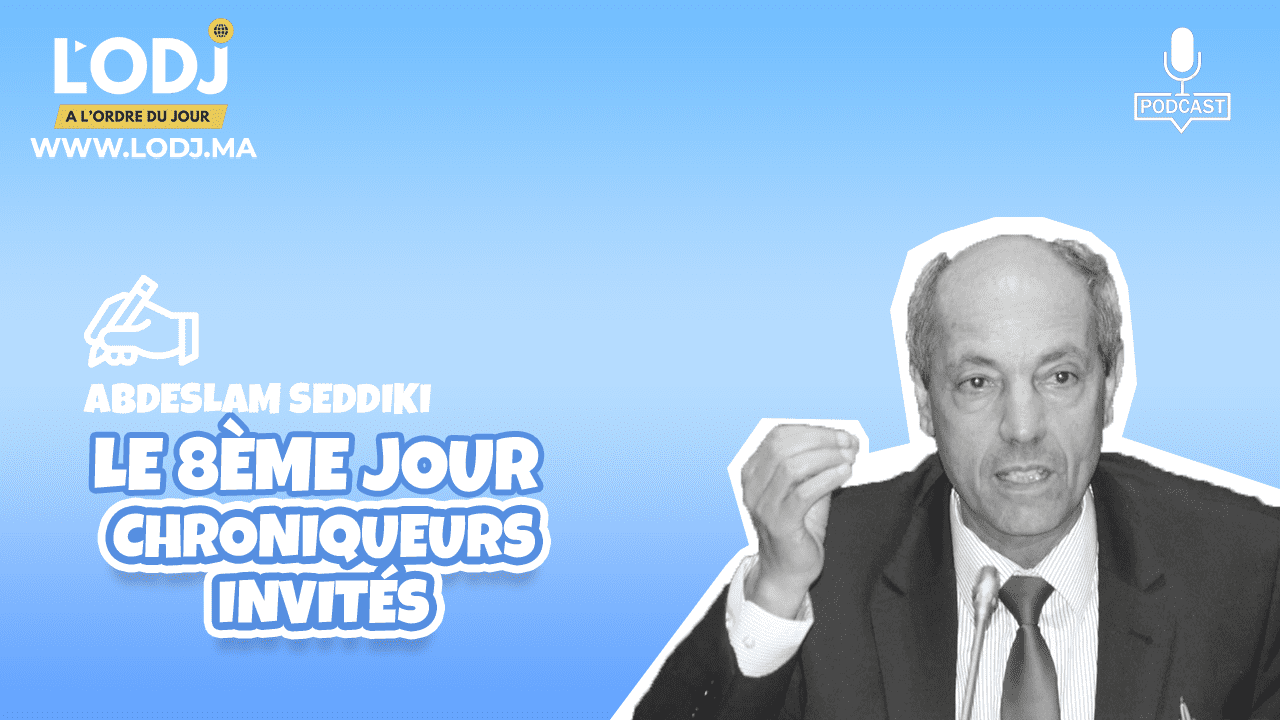




 Médecins libéraux : exclus du système, mais bons pour la moitié des soins ?
Médecins libéraux : exclus du système, mais bons pour la moitié des soins ?
















