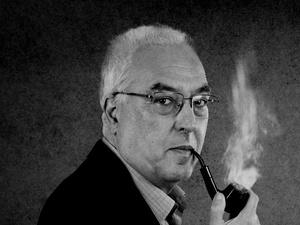Par Adnane Benchakroun
La panique boursière qui a suivi le « Jour de la libération » proclamé par Donald Trump – cette journée du 2 avril 2025 où il a brutalement imposé des droits de douane massifs – a-t-elle été un accident de politique économique ou, au contraire, une opération tactique mûrement réfléchie ? Certains analystes commencent à évoquer une stratégie plus sournoise : pousser les Américains à fuir la Bourse pour placer leur argent dans les bons du Trésor, allégeant ainsi la pression sur le financement de la dette fédérale. Une hypothèse qui mérite d’être creusée.
Une dette colossale, un besoin de refinancement urgent
Au cœur du raisonnement : la dette publique américaine. En 2025, celle-ci atteint un sommet historique, flirtant avec les 37 000 milliards de dollars. Le Congrès a beau s’agiter autour des plafonds d’endettement, la réalité est implacable : pour financer son déficit et ses plans de relance massifs, l’État fédéral a besoin d’acheteurs pour ses titres de dette, notamment les fameux « T-bonds ».
Or, ces derniers peinent à séduire dans un environnement de taux réels négatifs, de déficit budgétaire chronique et de désintérêt croissant des grandes puissances étrangères (comme la Chine ou le Japon) qui diversifient leurs réserves.
Or, ces derniers peinent à séduire dans un environnement de taux réels négatifs, de déficit budgétaire chronique et de désintérêt croissant des grandes puissances étrangères (comme la Chine ou le Japon) qui diversifient leurs réserves.
Un krach comme incitation indirecte à l’investissement public ?
C’est ici qu’intervient la thèse audacieuse : en provoquant un choc boursier massif – via une annonce spectaculaire et volontairement désorganisatrice comme les tarifs douaniers généralisés –, Trump aurait sciemment créé un climat d’aversion au risque sur les marchés. Objectif caché : déclencher une fuite des capitaux de la sphère boursière vers les valeurs refuges, au premier rang desquelles… les bons du Trésor américain. Car malgré leur faible rendement, ceux-ci bénéficient d’une image de sécurité absolue, surtout en période d’instabilité.
Cette stratégie, selon certains experts, serait même discutée au sein de cercles proches du Trésor américain. L’idée ? Transformer la peur en opportunité. Rassurer ensuite les marchés avec des messages contrôlés, tout en dirigeant discrètement l’épargne nationale vers le financement public, indispensable au maintien de l’appareil d’État américain.
Cette stratégie, selon certains experts, serait même discutée au sein de cercles proches du Trésor américain. L’idée ? Transformer la peur en opportunité. Rassurer ensuite les marchés avec des messages contrôlés, tout en dirigeant discrètement l’épargne nationale vers le financement public, indispensable au maintien de l’appareil d’État américain.
Les grands patrons de la Tech en embuscade
Autre élément troublant : la relative modération des géants de la tech. Apple, Amazon, Google, Meta… tous ont vu leur capitalisation chuter drastiquement après le krach, mais leurs dirigeants n’ont pas condamné frontalement Trump. Pire : selon des sources internes, certains d’entre eux auraient discuté avec les conseillers du président pour obtenir des exonérations tarifaires ciblées, en échange d’un soutien tacite à la nouvelle orientation économique.
Ces mastodontes disposent d’importantes réserves de cash logées à l’étranger ou dans des actifs liquides. En coulisses, ils pourraient donc eux aussi profiter d’un environnement où les rendements des bons du Trésor augmentent légèrement grâce à l’afflux de capitaux, tout en récupérant des conditions préférentielles pour leurs approvisionnements.
Ces mastodontes disposent d’importantes réserves de cash logées à l’étranger ou dans des actifs liquides. En coulisses, ils pourraient donc eux aussi profiter d’un environnement où les rendements des bons du Trésor augmentent légèrement grâce à l’afflux de capitaux, tout en récupérant des conditions préférentielles pour leurs approvisionnements.
Une vision « trumpienne » de la souveraineté financière
Trump ne l’a jamais caché : il rêve d’un retour au nationalisme économique, à la souveraineté budgétaire et à une forme d’indépendance financière des États-Unis vis-à-vis de l’Asie. Son obsession : réduire la dépendance au financement étranger. En forçant les Américains à recentrer leur épargne sur les bons du Trésor, il affaiblit Wall Street… mais renforce Washington. C’est une logique de puissance, brutale mais cohérente dans sa vision.
Une manœuvre à haut risque
S’il est avéré que cette manœuvre a été intentionnelle, elle pourrait s’apparenter à un coup de poker géopolitique : sacrifier à court terme la stabilité des marchés pour réorienter l’économie vers une forme de discipline budgétaire forcée. Mais le pari est risqué : la confiance des investisseurs internationaux pourrait s’éroder durablement, la consommation intérieure pourrait ralentir, et les effets sur l’emploi seraient ravageurs en cas de récession prolongée.
Trump a-t-il fait craquer l’ordre financier mondial pour sauver les finances publiques américaines ? Ce n’est plus de la science-fiction. C’est peut-être, déjà, le nouveau visage de l’économie politique en 2025.
Trump a-t-il fait craquer l’ordre financier mondial pour sauver les finances publiques américaines ? Ce n’est plus de la science-fiction. C’est peut-être, déjà, le nouveau visage de l’économie politique en 2025.












 L'accueil
L'accueil