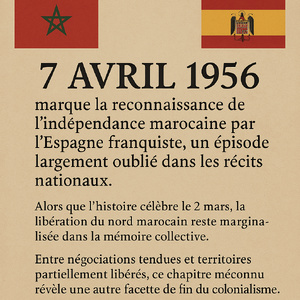Une libération à deux temps, et un seul souvenir officiel
C’est une date que l’on devrait tous connaître. Une date que l’on devrait enseigner, célébrer, commémorer. Et pourtant, le 7 avril 1956 passe chaque année dans un silence presque total. Comme une vérité oubliée ou volontairement reléguée au second plan. Ce jour-là, l’Espagne franquiste, après des décennies de présence coloniale au nord du Maroc et dans certaines zones stratégiques du pays, finit par céder. Elle reconnaissait — enfin — que le Maroc ne pouvait plus être morcelé, administré ou retenu. Ce fut l’autre acte fondateur de l’indépendance marocaine, un mois après que la France ait fait de même.
Mais pourquoi cette date, pourtant cruciale, est-elle si peu ancrée dans notre mémoire collective ?
L’histoire officielle retient volontiers le 2 mars 1956 : l’indépendance du Maroc face à la France. Cérémonies, photos, discours — tout y est. Mais le 7 avril, lui, reste en marge. Pourtant, sans l’accord obtenu de Madrid, l’indépendance marocaine n’aurait été qu’une semi-vérité. La France avait libéré une partie du pays, certes, mais l’Espagne, elle, conservait encore son emprise sur le nord (Tétouan, Larache, Chefchaouen) et sur le sud saharien. Franco temporisait, probablement dans l’espoir d’un compromis à son avantage, pendant que la scène internationale grondait sous les appels à la décolonisation.
Le roi Mohammed V, récemment revenu d’exil, ne s’en laissa pas conter. Avec son fils, le futur Hassan II et le mouvement national , il mena une campagne diplomatique méthodique et déterminée. Leur objectif : faire reconnaître l’unité du territoire marocain comme une urgence historique. Et il fallait convaincre une Espagne encore autoritaire, encore coloniale, encore nostalgique de sa grandeur impériale.
Le 7 avril 1956, l’Espagne reconnaît officiellement l’indépendance du Maroc et transfère le contrôle de ses zones au nord. Une page se tourne, une autre commence. Les scènes de liesse éclatent. Pourtant, l’histoire nationale oubliera trop souvent ce chapitre.
La réalité est plus nuancée : l’accord du 7 avril n’était pas une libération totale. Si le nord revenait dans le giron national, l’Espagne conservait ses “bijoux coloniaux” : Sebta, Melilia, le Sahara. Il fallut attendre 1958 pour voir Tarfaya réintégrer le Royaume. Et pour le Sahara, l’histoire restera en suspens jusqu'à la marche verte de 1975 — une autre page, toujours ouverte les villes de Sebta et Mélilia.
Pourquoi cette mémoire sélective ? Serait-ce parce que la fin du protectorat français servait mieux la narration d’une indépendance glorieuse et complète ? Le narratif national aime les histoires claires, avec des héros, des dates fixes, et un ennemi facilement identifiable. L’Espagne, elle, se glissa entre les lignes de ce récit officiel, et le 7 avril fut oublié.
Car même après cette double reconnaissance, le plus dur restait à faire. Comment reconstruire un État après plus de quarante années d’administration étrangère ? Il fallut marocaniser les institutions, repenser l’éducation, relancer une économie longtemps exploitée par les puissances européennes. Ce fut un chantier titanesque. Mohammed V en posa les fondations, Hassan II en fit le socle d’un régime fort et centralisé. Le défi, aujourd’hui encore, reste de continuer à bâtir sur cette indépendance politique une véritable souveraineté populaire, économique, culturelle.
Le passé colonial espagnol, lui, n’a pas disparu. Il hante encore les ruelles de Tétouan ou de Larache, dans les façades ibériques, dans certaines pratiques administratives, voire dans les mentalités. Une mémoire matérielle toujours visible, mais peu questionnée.
Alors que les jeunes générations ignorent souvent que l’indépendance du Maroc fut un processus à deux visages, il est peut-être temps de rééquilibrer le récit. D’oser parler du 7 avril avec la même fierté que du 2 mars. Car une nation ne se construit pas sur des oublis, mais sur une reconnaissance sincère de ses combats pluriels.
Mais pourquoi cette date, pourtant cruciale, est-elle si peu ancrée dans notre mémoire collective ?
L’histoire officielle retient volontiers le 2 mars 1956 : l’indépendance du Maroc face à la France. Cérémonies, photos, discours — tout y est. Mais le 7 avril, lui, reste en marge. Pourtant, sans l’accord obtenu de Madrid, l’indépendance marocaine n’aurait été qu’une semi-vérité. La France avait libéré une partie du pays, certes, mais l’Espagne, elle, conservait encore son emprise sur le nord (Tétouan, Larache, Chefchaouen) et sur le sud saharien. Franco temporisait, probablement dans l’espoir d’un compromis à son avantage, pendant que la scène internationale grondait sous les appels à la décolonisation.
Le roi Mohammed V, récemment revenu d’exil, ne s’en laissa pas conter. Avec son fils, le futur Hassan II et le mouvement national , il mena une campagne diplomatique méthodique et déterminée. Leur objectif : faire reconnaître l’unité du territoire marocain comme une urgence historique. Et il fallait convaincre une Espagne encore autoritaire, encore coloniale, encore nostalgique de sa grandeur impériale.
Le 7 avril 1956, l’Espagne reconnaît officiellement l’indépendance du Maroc et transfère le contrôle de ses zones au nord. Une page se tourne, une autre commence. Les scènes de liesse éclatent. Pourtant, l’histoire nationale oubliera trop souvent ce chapitre.
La réalité est plus nuancée : l’accord du 7 avril n’était pas une libération totale. Si le nord revenait dans le giron national, l’Espagne conservait ses “bijoux coloniaux” : Sebta, Melilia, le Sahara. Il fallut attendre 1958 pour voir Tarfaya réintégrer le Royaume. Et pour le Sahara, l’histoire restera en suspens jusqu'à la marche verte de 1975 — une autre page, toujours ouverte les villes de Sebta et Mélilia.
Pourquoi cette mémoire sélective ? Serait-ce parce que la fin du protectorat français servait mieux la narration d’une indépendance glorieuse et complète ? Le narratif national aime les histoires claires, avec des héros, des dates fixes, et un ennemi facilement identifiable. L’Espagne, elle, se glissa entre les lignes de ce récit officiel, et le 7 avril fut oublié.
Car même après cette double reconnaissance, le plus dur restait à faire. Comment reconstruire un État après plus de quarante années d’administration étrangère ? Il fallut marocaniser les institutions, repenser l’éducation, relancer une économie longtemps exploitée par les puissances européennes. Ce fut un chantier titanesque. Mohammed V en posa les fondations, Hassan II en fit le socle d’un régime fort et centralisé. Le défi, aujourd’hui encore, reste de continuer à bâtir sur cette indépendance politique une véritable souveraineté populaire, économique, culturelle.
Le passé colonial espagnol, lui, n’a pas disparu. Il hante encore les ruelles de Tétouan ou de Larache, dans les façades ibériques, dans certaines pratiques administratives, voire dans les mentalités. Une mémoire matérielle toujours visible, mais peu questionnée.
Alors que les jeunes générations ignorent souvent que l’indépendance du Maroc fut un processus à deux visages, il est peut-être temps de rééquilibrer le récit. D’oser parler du 7 avril avec la même fierté que du 2 mars. Car une nation ne se construit pas sur des oublis, mais sur une reconnaissance sincère de ses combats pluriels.












 L'accueil
L'accueil