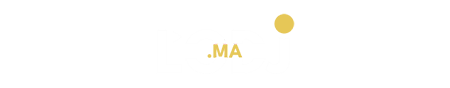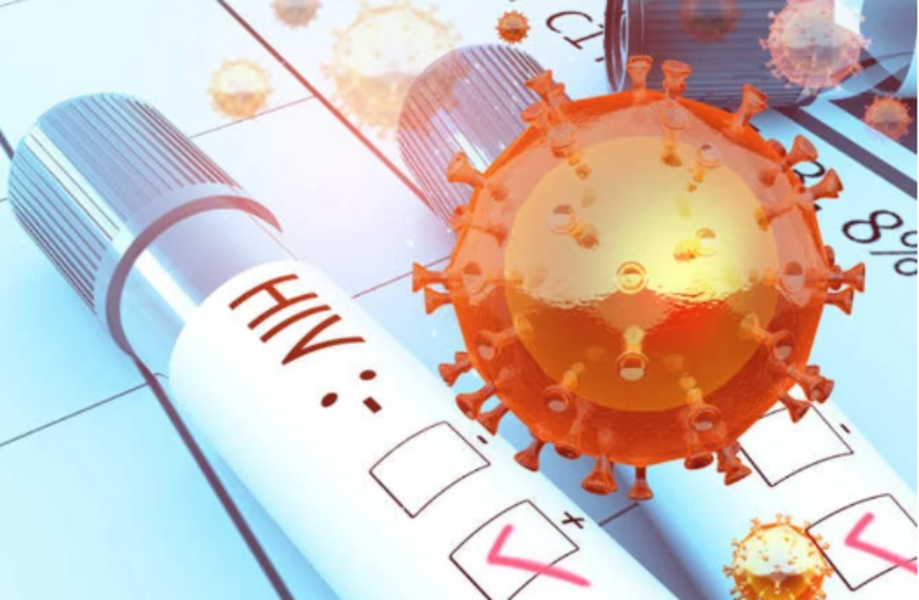
Selon Frontline AIDS, le Maroc se positionne aujourd’hui comme un acteur déterminé dans la lutte contre le VIH, notamment grâce à la mise en œuvre d’un nouveau Plan stratégique intégré (2024-2030) couvrant le VIH, les IST et l’hépatite virale. Ce plan se distingue par une approche inclusive, qui place les populations clés au cœur des politiques de santé, en les impliquant activement dans leur conception et leur mise en œuvre. Piloté par le groupe de travail technique national, ce dispositif permet à la société civile de jouer un rôle central dans la riposte nationale, contribuant ainsi à l’amélioration notable du paysage sanitaire.
Les résultats obtenus sont encourageants : entre 2010 et 2023, le Maroc a enregistré une baisse de 35 % des nouvelles infections au VIH. Aujourd’hui, 78 % des personnes vivant avec le virus connaissent leur statut sérologique, 74 % ont accès au traitement antirétroviral (ARV) et 66 % bénéficient d’une suppression virale efficace, se rapprochant des objectifs mondiaux 95-95-95 fixés par l’ONUSIDA.
Le financement de cette lutte repose principalement sur les contributions du ministère de la Santé et du Fonds mondial, avec une attention particulière portée à la disponibilité des ARV. Le budget alloué à la prévention a également été renforcé. Par ailleurs, près de 70 % de la population bénéficie d’une couverture médicale, un élément crucial pour garantir l’accès aux soins.
Le pays s’appuie également sur des institutions de veille comme le Conseil national des droits de l’homme, ainsi que sur une Stratégie nationale dédiée aux droits humains et à la santé. Cette dernière vise à réduire la stigmatisation liée au VIH. Selon l’Indice de stigmatisation 2022, des avancées notables ont été enregistrées depuis 2016, témoignant d’un changement positif dans la perception du VIH au sein de la société.
Cependant, des défis persistent. Frontline AIDS souligne notamment la dépendance de la société civile à des financements extérieurs, ainsi que les lacunes en matière de suivi et d’évaluation des dépenses nationales. Si le ministère de la Santé assure l’essentiel du financement, la question de la durabilité reste posée, et une implication plus forte du secteur privé apparaît nécessaire.
Malgré la disponibilité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), son accès reste limité, notamment dans les zones rurales, en raison d’une sensibilisation encore insuffisante aux risques liés au VIH. À cela s’ajoutent des normes de genre contraignantes, des ruptures dans l’approvisionnement en ARV, en tests de dépistage et en préservatifs, qui nuisent à l’efficacité de la réponse nationale.
Au niveau régional, l’Alliance note une situation inquiétante : entre 2010 et 2023, le nombre de nouvelles infections au VIH a augmenté de 116 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Rien qu’en 2023, 22 962 nouveaux cas ont été recensés dans la région, représentant 1,77 % des infections mondiales.
Le rapport déplore un sous-financement persistant des efforts de prévention, avec seulement 15 % des ressources nécessaires actuellement mobilisées. La fermeture du bureau de l’ONUSIDA dans la région, combinée à un manque de coordination entre les agences onusiennes, les gouvernements et les réseaux communautaires, ne fait qu’aggraver la crise.