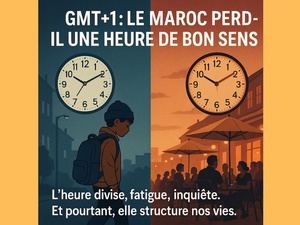Pendant plusieurs années, le Maroc avait adopté le fuseau horaire GMT+1, à l’exception du mois de Ramadan où il revenait temporairement au GMT. Ce choix, présenté comme pragmatique, avait pourtant suscité de nombreuses interrogations dans l’opinion publique. Une étude commandée à l’époque par le cabinet PwC avait tenté de clarifier les enjeux en listant les avantages et les inconvénients de cette orientation. Au-delà des considérations techniques, la question avait pris une tournure profondément sociale, énergétique et politique.
Dès les premières lignes de l’enquête, un constat s’imposait : la lassitude des citoyens et des entreprises face au changement d’heure était palpable. À l’époque, 68 % des personnes interrogées et 63 % des structures sondées avaient exprimé leur opposition à l’alternance horaire. Ce n’était pas tant le choix du fuseau qui posait problème, mais la discontinuité chronologique, perçue comme une source de perturbation tant dans la vie quotidienne que dans la gestion des activités économiques.
Les partisans du GMT+1, eux, avaient mis en avant des bénéfices immédiats. La prolongation de la clarté en soirée permettait, selon eux, d’encourager les activités culturelles et de stimuler la consommation intérieure. Certains secteurs comme l’offshoring, étroitement liés aux horaires européens, y trouvaient également leur compte. Sur le papier, cette option permettait aussi de réaliser quelques économies d’énergie et de réduire marginalement les émissions de gaz à effet de serre. Ces arguments, bien que séduisants, s’étaient révélés moins solides à l’épreuve des faits.
Car dans la réalité, les effets secondaires du GMT+1 avaient rapidement suscité des tensions. Les matinées hivernales plongées dans le noir avaient nourri un sentiment d’insécurité, notamment pour les enfants et les femmes sortant tôt le matin. Dans les écoles, plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer une baisse de concentration chez les élèves, une fatigue accrue et un impact négatif sur leur bien-être. Le dérèglement de l’horloge biologique n’avait pas épargné les salariés non plus. Quant à la promesse d’économies d’énergie, elle s’était heurtée à une hausse de la consommation électrique en matinée. Sans oublier les dépenses publiques supplémentaires induites par la nécessité d’adapter l’éclairage urbain, d’ajuster les transports et de renforcer la sécurité dans les espaces publics.
L’étude de PwC, en conclusion, avait recommandé au gouvernement de rompre avec le modèle instable d’alternance entre GMT et GMT+1, et de se fixer une bonne fois pour toutes sur un seul fuseau. Trois scénarios étaient sur la table : adopter le GMT de manière permanente, maintenir le GMT+1 toute l’année, ou poursuivre le va-et-vient saisonnier. Le cabinet avait tranché : le véritable problème ne résidait pas dans le fuseau choisi, mais dans la répétition des changements, qui déstabilisait les individus et les organisations.
Pour accompagner ce changement de cap, PwC avait proposé un ensemble de mesures transversales : élargir la consultation institutionnelle, réviser le cadre légal de l’heure légale, anticiper la communication auprès des secteurs stratégiques comme les transports ou les télécoms, et mettre en place une évaluation continue des effets du fuseau choisi.
Dans le cas d’un retour au GMT, des investissements énergétiques auraient été nécessaires pour couvrir les pics de consommation, estimés à 0,17 % de la consommation annuelle, soit environ 220 millions de dirhams par an. Le développement des énergies renouvelables figurait parmi les pistes préconisées. En revanche, si le Maroc optait pour le maintien du GMT+1, il devenait impératif de réaménager les horaires scolaires, d’introduire davantage de flexibilité dans les entreprises, et d’ouvrir un dialogue social structuré avec les syndicats et la CGEM afin d’anticiper les risques de désynchronisation entre la vie professionnelle et les rythmes biologiques.
Ce débat sur l’heure légale, qui pouvait sembler technique, avait finalement révélé de profondes tensions dans la manière dont le Maroc envisageait son rapport au temps. Loin d’être un simple détail administratif, le choix du fuseau horaire avait mis en lumière un besoin pressant de cohérence, de transparence et de stabilité. Reste à savoir si les enseignements de cette période seront véritablement pris en compte, ou s’ils resteront une fois de plus coincés entre deux aiguilles.
Dès les premières lignes de l’enquête, un constat s’imposait : la lassitude des citoyens et des entreprises face au changement d’heure était palpable. À l’époque, 68 % des personnes interrogées et 63 % des structures sondées avaient exprimé leur opposition à l’alternance horaire. Ce n’était pas tant le choix du fuseau qui posait problème, mais la discontinuité chronologique, perçue comme une source de perturbation tant dans la vie quotidienne que dans la gestion des activités économiques.
Les partisans du GMT+1, eux, avaient mis en avant des bénéfices immédiats. La prolongation de la clarté en soirée permettait, selon eux, d’encourager les activités culturelles et de stimuler la consommation intérieure. Certains secteurs comme l’offshoring, étroitement liés aux horaires européens, y trouvaient également leur compte. Sur le papier, cette option permettait aussi de réaliser quelques économies d’énergie et de réduire marginalement les émissions de gaz à effet de serre. Ces arguments, bien que séduisants, s’étaient révélés moins solides à l’épreuve des faits.
Car dans la réalité, les effets secondaires du GMT+1 avaient rapidement suscité des tensions. Les matinées hivernales plongées dans le noir avaient nourri un sentiment d’insécurité, notamment pour les enfants et les femmes sortant tôt le matin. Dans les écoles, plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer une baisse de concentration chez les élèves, une fatigue accrue et un impact négatif sur leur bien-être. Le dérèglement de l’horloge biologique n’avait pas épargné les salariés non plus. Quant à la promesse d’économies d’énergie, elle s’était heurtée à une hausse de la consommation électrique en matinée. Sans oublier les dépenses publiques supplémentaires induites par la nécessité d’adapter l’éclairage urbain, d’ajuster les transports et de renforcer la sécurité dans les espaces publics.
L’étude de PwC, en conclusion, avait recommandé au gouvernement de rompre avec le modèle instable d’alternance entre GMT et GMT+1, et de se fixer une bonne fois pour toutes sur un seul fuseau. Trois scénarios étaient sur la table : adopter le GMT de manière permanente, maintenir le GMT+1 toute l’année, ou poursuivre le va-et-vient saisonnier. Le cabinet avait tranché : le véritable problème ne résidait pas dans le fuseau choisi, mais dans la répétition des changements, qui déstabilisait les individus et les organisations.
Pour accompagner ce changement de cap, PwC avait proposé un ensemble de mesures transversales : élargir la consultation institutionnelle, réviser le cadre légal de l’heure légale, anticiper la communication auprès des secteurs stratégiques comme les transports ou les télécoms, et mettre en place une évaluation continue des effets du fuseau choisi.
Dans le cas d’un retour au GMT, des investissements énergétiques auraient été nécessaires pour couvrir les pics de consommation, estimés à 0,17 % de la consommation annuelle, soit environ 220 millions de dirhams par an. Le développement des énergies renouvelables figurait parmi les pistes préconisées. En revanche, si le Maroc optait pour le maintien du GMT+1, il devenait impératif de réaménager les horaires scolaires, d’introduire davantage de flexibilité dans les entreprises, et d’ouvrir un dialogue social structuré avec les syndicats et la CGEM afin d’anticiper les risques de désynchronisation entre la vie professionnelle et les rythmes biologiques.
Ce débat sur l’heure légale, qui pouvait sembler technique, avait finalement révélé de profondes tensions dans la manière dont le Maroc envisageait son rapport au temps. Loin d’être un simple détail administratif, le choix du fuseau horaire avait mis en lumière un besoin pressant de cohérence, de transparence et de stabilité. Reste à savoir si les enseignements de cette période seront véritablement pris en compte, ou s’ils resteront une fois de plus coincés entre deux aiguilles.












 L'accueil
L'accueil