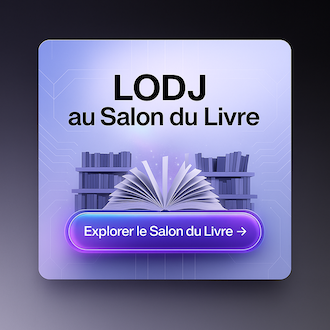Quand les faits vacillent / Réseaux sociaux : catalyseurs du chaos cognitif et La fin de l’autorité épistémique ?
Un monde saturé d’informations mais appauvri en certitudes : voilà le terrain sur lequel s’exerce aujourd’hui la gouvernance. Le rapport stratégique 2024-2025 de l’IRES consacre un chapitre troublant à un phénomène qui ronge lentement les fondements de la décision publique : la post-vérité. Lorsque les faits ne font plus autorité, que reste-t-il pour gouverner ?
La post-vérité, ce n’est pas seulement le mensonge. C’est la perte de consensus sur ce qui constitue une réalité partagée. C’est l’ère où une vidéo décontextualisée vaut plus qu’un rapport d’expert. Où l’émotion remplace la preuve. Où la croyance personnelle prime sur les faits vérifiés.
Ce brouillard cognitif n’est pas sans conséquence. La décision publique devient suspecte, contestée en permanence. Chaque réforme est perçue comme une manipulation, chaque donnée comme une construction idéologique. La gouvernance glisse alors vers la défiance généralisée.
Le rapport pointe du doigt l’effet amplificateur des plateformes numériques, qui favorisent la viralité des récits simples au détriment des analyses complexes. Les algorithmes privilégient ce qui choque, ce qui divise, ce qui confirme les biais existants. Résultat : les citoyens ne partagent plus un espace commun de débat, mais des bulles de récits incompatibles.
Les gouvernants, de leur côté, sont tentés de jouer le même jeu : simplification excessive, storytelling émotionnel, mise en scène du pouvoir. Mais cela alimente encore davantage la spirale de suspicion.
Autre victime de la post-vérité : l’expert. Jadis figure d’autorité, il est désormais accusé de collusion, de biais, voire de faire partie du “système”. Cette crise de la parole savante empêche la construction de politiques publiques solides. Comment justifier une décision sanitaire, environnementale ou fiscale, si plus personne ne croit aux données qui la fondent ?
L’IRES insiste : le rétablissement d’une gouvernance efficace passe par la reconstruction d’un pacte de confiance cognitif. Cela suppose de repenser l’information publique, de créer des espaces de débat contradictoire, et de garantir la transparence des processus de décision.
L’un des leviers proposés est la “pédagogie de la complexité”. Plutôt que de simplifier à outrance, il faut apprendre à expliquer les incertitudes, à assumer les dilemmes, à reconnaître les limites. C’est une gouvernance plus lente, moins spectaculaire, mais plus résiliente. Une gouvernance qui mise sur l’intelligence des citoyens au lieu de flatter leurs instincts.
La post-vérité, ce n’est pas seulement le mensonge. C’est la perte de consensus sur ce qui constitue une réalité partagée. C’est l’ère où une vidéo décontextualisée vaut plus qu’un rapport d’expert. Où l’émotion remplace la preuve. Où la croyance personnelle prime sur les faits vérifiés.
Ce brouillard cognitif n’est pas sans conséquence. La décision publique devient suspecte, contestée en permanence. Chaque réforme est perçue comme une manipulation, chaque donnée comme une construction idéologique. La gouvernance glisse alors vers la défiance généralisée.
Le rapport pointe du doigt l’effet amplificateur des plateformes numériques, qui favorisent la viralité des récits simples au détriment des analyses complexes. Les algorithmes privilégient ce qui choque, ce qui divise, ce qui confirme les biais existants. Résultat : les citoyens ne partagent plus un espace commun de débat, mais des bulles de récits incompatibles.
Les gouvernants, de leur côté, sont tentés de jouer le même jeu : simplification excessive, storytelling émotionnel, mise en scène du pouvoir. Mais cela alimente encore davantage la spirale de suspicion.
Autre victime de la post-vérité : l’expert. Jadis figure d’autorité, il est désormais accusé de collusion, de biais, voire de faire partie du “système”. Cette crise de la parole savante empêche la construction de politiques publiques solides. Comment justifier une décision sanitaire, environnementale ou fiscale, si plus personne ne croit aux données qui la fondent ?
L’IRES insiste : le rétablissement d’une gouvernance efficace passe par la reconstruction d’un pacte de confiance cognitif. Cela suppose de repenser l’information publique, de créer des espaces de débat contradictoire, et de garantir la transparence des processus de décision.
L’un des leviers proposés est la “pédagogie de la complexité”. Plutôt que de simplifier à outrance, il faut apprendre à expliquer les incertitudes, à assumer les dilemmes, à reconnaître les limites. C’est une gouvernance plus lente, moins spectaculaire, mais plus résiliente. Une gouvernance qui mise sur l’intelligence des citoyens au lieu de flatter leurs instincts.
Mais peut-on vraiment gouverner à découvert dans un monde de guerre cognitive ?
La post-vérité n’est pas un accident, c’est une arme politique. Elle est utilisée délibérément pour semer le doute, délégitimer l’adversaire, et fragmenter l’opinion. Dans ce contexte, le pari de la pédagogie paraît bien naïf. Peut-être faut-il une gouvernance plus offensive, capable de reprendre le contrôle narratif, quitte à manier elle aussi des outils de persuasion. Gouverner par la vérité… ou périr dans le silence ?












 L'accueil
L'accueil