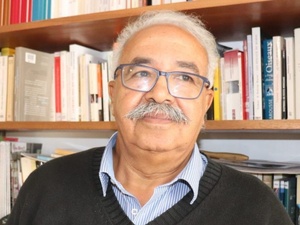À l’occasion du SIEL 2025, Hachemi SALHI a bien voulu accorder un entretien à L’ODJ Média, que nous remercions chaleureusement pour cette précieuse contribution.
Vous avez souvent écrit sur la mémoire : la mémoire des lieux, des figures oubliées, des gestes enfouis. Que représente pour vous le livre dans ce travail de préservation silencieuse ?
Le livre est un merveilleux abri de la mémoire, des mémoires.
Il est des mémoires heureuses, enchantées, nostalgiques d’un temps révolu, d’une enfance, d’une période de la vie, d’une histoire d’amour ou de désamour. Il y a d’autres mémoires plus malheureuses, fissurées, défaites, fragmentées ou blessées par une trajectoire de vie ou par l’histoire politique, ses violences et injustices. Ces deux types de mémoire peuvent, bien entendu, cohabiter dans un parcours de vie, dans la société et l’histoire.
Ces multiples mémoires trouvent toutes, me semble-t-il leur expression dans une formule livresque différenciée. Une mémoire heureuse (ou malheureuse) individuelle et personnelle peut trouver refuge dans un recueil poétique. Une mémoire collective, historique sera condensée dans un récit, un livre d’histoire, une épopée romancée.
Le livre est en quelque sorte une maison d’hospitalité pour la mémoire, pour toutes les formes de mémoire (individuelle, familiale, collective, historique).
C’est Edmond Jabès (1912-1991) qui avait cette belle définition du livre : « Le livre est la seule demeure de l’écrivain. Immense est l’hospitalité du livre ».
Le livre est le lieu d’expression de l’imaginaire.
Le livre libère l’imagination et permet à toute personne de puiser dans sa créativité, ses lectures, ses souvenirs pour ouvrir son cœur, son âme et sa raison à l’autre, aux autres groupes culturels ou géographiques. Il ouvre à des horizons multiples et infinis. Le livre compose également un florilège d’émotions singulières. C’est une main tendue à l’imaginaire du temps passé, présent et futur. Le livre fait vivre, rire, distraire, pleurer et penser.
Il permet d’ouvrir notre « grande armoire intérieure, remplie de millions de tiroirs, tout ce qu’on a appris et aimé est là, bien rangé au fond de soi : les gens, les choses, les animaux et les plantes…Même des choses qu’on croit avoir oubliées. Et certaines phrases aussi ! Et des chants, des odeurs, des mots et des poésies », dit l’auteure Kochka dans son ouvrage « Frères d’exil ».
Le livre est une île aux trésors pour les jeunes de 7 ans (ou moins) à 77 ans (et plus). La magie des mots est un apprentissage de la vie d’hommes et de femmes, des genres et de toutes les diversités. C’est aussi une séculière ouverture sur les langues, le monde, les cutures, les histoires et les géographies dans leurs variétés et combinaisons.
Le livre est un continent d’écriture plurielle et l’expression d’un style singulier ou plus personnel. Une fiction romanesque, une intrigue linguistique, une ode, une promenade sémantique et toutes les autres formes du livre s’entendent et se partagent à la fois dans le chant du monde et dans son for intérieur.
C’est la permanence d’une lecture silencieuse d’une écoute bienveillante et un dialogue un peu plus bruyant et agité avec l’espace-temps. Le livre demeure une humanité et une force mémorielle sans égale. L’invasion numérique libérale ne gommera jamais cette esthétique du silence qu’est le livre que des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants réels partagent en feuilletant des pages de félicité.
Une telle richesse ne se retrouve plus, malheureusement, dans la lecture digitalisée d’un pseudo village global que pense nous offrir l’économie libérale du numérique et du livre devenu artefact de l’intelligence artificielle. Alors qu’en réalité nous y restons des solitudes connectées à travers une servitude volontaire que prophétisait Etienne de La Boétie (1530-1563).
Les hommes ont perdu la mémoire de leur liberté naturelle, disait-il. Il faut absolument faire lire à nos jeunes son opuscule « Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un » que nous pouvons lire aujourd’hui comme un réquisitoire contre l’absolutisme… numérique. Et rendre hommage à La Boétie comme un lanceur d’alerte du 16ème siècle.
Il y a dans le livre en général une préhension active du monde qui n’a rien à voir avec la consommation passive d’un flux d’informations courtes, prédigérées et sujettes à caution. Le livre c’est de la pâte humaine, un imaginaire sans algorithme, une liberté de tous les instants.
Le livre est un partage engagé.
On y partage la mémoire du monde et le silence des oiseaux migrateurs. On y partage la joie et la tristesse. Ce sont des pages d’humanité qui se transmettent entre les personnes, les cultures et les générations. « Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, voilà ce que je crois », écrivait Franz Kafka à son ami Oscar Pollak, le 27 janvier 1904.
Le livre est le meilleur rempart contre les affres de la solitude ou de l’exil.
Le livre donne la parole aux personnes humbles, aux oubliés, aux taiseux, aux victimes oubliées des violences de l’histoire, de la guerre et des conflits sociaux.
Il est le lieu d’expression d’une pensée critique, d’un engagement sociopolitique et du partage d’un projet de société plus humaine et solidaire. Le livre est l’un des premiers lanceurs d’alerte contre les injustices, les violences et la préservation des libertés tant individuelles que collectives.
Comment, selon vous, la littérature peut-elle combler le fossé entre les générations d’une diaspora parfois coupée de ses racines linguistiques et culturelles ?
La littérature est une langue et plusieurs langues à la fois. C’est le philosophe Jacques Derrida qui dit « On ne parle jamais qu’une seule langue. On ne parle jamais une seule langue »
La littérature est un condensé de société, culture, d’histoire et géographie. C’est un imaginaire particulier ou local mais qui est traversé par d’autres imaginaires, d’autres mondes.
La littérature est une polyphonie que ne contraint pas l’espace-temps. De toutes ces composantes, elle est un éternel et vivant passeur de mémoire entre les générations. Les enfants de la diaspora gardent consciemment ou inconsciemment les fragments des racines héritées de leurs parents devenus migrants. Je pense que les racines linguistiques et culturelles restent vivaces dans l’espace privé, familial, dans les fêtes comme dans les deuils. Il y a dans l’immigration un partage communautaire de ces racines. Elles sont, bien entendu, traversées par les cultures et les littératures des pays d’accueil. Ce dialogue plus ou moins formalisé est enrichissant parce source de différences.
« Je suis ivre des autres, des contacts. Je suis pétri par les autres », dit l’académicien français Erik Orsenna.
Je pense, qu’à l’heure contemporaine des grands moyens de communication et d’information, il n’y a pas de fossé qu’on ne peut plus ou moins combler. On ne peut, cependant, pas tout combler ou chercher à homogénéiser les deux espaces ou continents. Dans le trajet migratoire, il y a des gains et des pertes et des recompositions hybrides spécifiques.
Et c’est le génie de la littérature de donner naissance à ce lieu de partage entre les générations qui n’est pas toujours calme mais traversé de turbulences socioculturelles et linguistiques. « N’être qu’un est une prison », souligne Fernando Pessoa.
A travers vos ouvrages, vous invitez souvent à relire le passé sans nostalgie mais avec tendresse. Est-ce que cette démarche est comprise par les jeunes lecteurs ?
On ne peut se défaire du passé, de son passé. Bienheureux ou douloureux ou les deux à la fois, il a participé à votre construction d’homme ou de femme, inscrit dans une société et une histoire de plus en plus mondialisée ou universelle. Le passé reste aussi, quelque part, la nostalgie de l’enfance. On le relit avec délectation et bonheur. On gomme un peu les traits malheureux, moins beaux ou moins enchanteurs. Ce travail de pacification du passé est l’expression d’une véritable tendresse, comme vous le soulignez bien.
Cette opération de résilience en tant renaissance de sa propre souffrance est de plus en plus comprise par les jeunes lecteurs. Les travaux sur la résilience de Boris Cyrulnik nous aident énormément à cette lecture assagie du passé par les jeunes. Je pense aux livres « Un merveilleux malheur », « Sauve-toi, la vie t’appelle », « La nuit, j’écrirai des soleils ».
Qu’est ce qui, selon vous, empêche aujourd’hui la jeunesse marocaine - ici ou dans la diaspora – d’entrer en littérature ? Est-ce l’école, l’absence d’identification, ou la fragmentation numérique ?
Rien. Il faut garder en soi la part irréductible du rêve. Rien n’empêche un ou une jeune d’ici ou d’ailleurs d’entrer en écriture. Il faut un peu le vouloir personnellement comme il convient que des éléments socioculturels ou économiques de blocage soient levés par les instances scolaires et éducatives. Il faut effectivement véhiculer et insister sur le message que la littérature ou l’écriture n’est pas réservée à une élite, en particulier dans les jeunes de milieu populaire scolarisés dans les banlieues dites difficiles ou ségrégées.
Il ne faut plus que le jeune se dise « cela n’est pas pour moi ». L’anglais, le mandarin, l’opéra, le jazz, la sculpture, le roman, la poésie … ce n’est pas pour moi.
Non, il n’y pas un obstacle épistémologique, socioculturel ou financier insurmontable. Il est vrai, cependant, que les déshérités de l’école, de la société et de la cuture, pour reprendre l’expression du sociologue Pierre Bourdieu, ont plus de mal à accéder à la culture que les héritiers, d’autant plus que nous savons que les premiers ont un réflexe d’autocensure qui est l’intériorisation de leur destin social.
Ce sont les fameux déterminants sociaux et économiques de la reproduction. Et ce que les sciences sociales et psychologiques ont développé sous le terme de « prophétie autoréalisatrice » ou « autodestructrice ». C’est l’effet Pygmalion en pédagogie ou effet nocebo en médecine, un concept développé par les sociologues américains Robert King Merton et William Isaac Thomas.
L’école, les professeurs peuvent donc pour ne pas dire qu’ils sont essentiels à cette prise de conscience d’un potentiel créatif en chaque jeune élève quelle que soit sa nationalité ou origine culturelle. Cette projection bienveillante facilitera l’identification du jeune à de grandes figures littéraires ou artistiques du monde. « Tout doit être à tout le monde », dit encore Erik Orsenna.
Boris Vian disait en conclusion de la chanson « Pas pour moi » : « C’est pour moi les Corot du musée du Louvre… car dans les rues comme dans la tête... Tout est à moi... Tout est à moi ».
Quand les inhibitions et les obstacles sont levés, les jeunes sont enchantés par leur créativité réelle et potentielle.
J’ai vu et côtoyé des collégiennes et des collégiens, poètes en herbe doublement heureux. Heureux pour eux-mêmes et de partager leur créativité au collège, dans le quartier et au sein de la famille. Une expérience poétique que j’ai menée avec l’équipe pédagogique et une cohorte de collégiens des classes de cinquième d’une ville populaire de la région des Hauts-de-France, qui a duré cinq environ et abouti à la publication d’un livre intitulé « La Poésie est une grammaire douce », en 2023.
Les collégiens d’origines diverses étaient fiers de voir que leur livre se retrouve à la Bibliothèque Nationale de France (BnF), pour l’éternité, à côté des livres de Victor Hugo, Jean de La Fontaine, Molière, Driss Chraïbi, Abdellatif Laâbi, Kateb Yacine, Assia Djebar, Leïla Slimani, Mahmoud Darwich, Antoine de Saint Exupéry, et des Prix Nobel de littérature comme Sully Prudhomme, Wole Soyinka, Naguib Mahfouz, Pablo Neruda, Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux, Han Kang…
Comme vous le mentionnez, il y a les freins et les dégâts d’une certaine fracture digitale ou fragmentation numérique.
Celle-ci participe à ce que Michel Desmurget, docteur en neurosciences et directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et à l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod (France), nomme « La Fabrique du crétin digital » .
Le jeune qui devient un grand consommateur passif d’écrans perd tout pouvoir critique et ruine son potentiel imaginaire et créatif. Il est menacé non seulement par le surpoids ou l’obésité physiologique mais aussi l’obésité informationnelle et la consommation massive d’heures d’écrans (TV, smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeu, réseaux sociaux…) qui affectent ses facultés cognitives, son sommeil, son comportement et sa santé, avec une grave conséquence intellectuelle qui est la diminution drastique du temps de lecture.
On se retrouve, en fait, devant le paradoxe suivant : l’intelligence artificielle génère des idiots numériques, fabrique des crétins digitaux et massifie les handicapés de la lecture.
Je voudrais préciser qu’en tant qu’enfant du livre, septuagénaire, je suis un presque parfait idiot numérique. Je suis nul en manipulation numérique, je ne suis dans aucun réseau social, je ne sais pas faire de selfie, ni utiliser WhatsApp comme il faut, mon smartphone-cadeau empoisonné date d’un an. Un effet de génération sans doute mais je connais des pépés et des mémés qui sont de véritables geeks en informatique et IA. Moi, je suis heureux avec le livre ! La lecture est un émerveillement de tous les âges qui m’apprend encore à grandir et penser.
Nous savons, par ailleurs, que l’intelligence artificielle présente des scripts ou fictions littéraires ready made qui pervertissent la future création littéraire de nos jeunes.
Il faut donc rétablir, coûte que coûte, l’amour de la lecture et du livre chez nos jeunes. C’est la lecture qui est une machine à créer de l’intelligence et de l’émotion. Une soft machine, pour les nostalgiques de la pop’music et du flower power !
Vous avez choisi la poésie comme passerelle pour éveiller à la lecture. Pourquoi ce genre, souvent, jugé difficile, vous semble-t-il plus accessible émotionnellement ?
La lecture mène naturellement à l’écriture. La poésie est le langage de la liberté, par excellence. En particulier avec la poésie libre, le rap ou le slam d’aujourd’hui. La lecture est une agréable familiarité avec les mots, leur étrangeté et leur beauté. Le poète jeune ou vieux est une personne qui cultive l’art de jouer avec les mots, leur sonorité, leur rythme et leur alliance pour construire des images, inspirer des sentiments et susciter des émotions.
C’est la découverte de cette créativité ludique qui va attirer les enfants dans le travail d’écriture poétique. C’est le jeu inventif et ingénieux avec les mots qui va les inciter à lire, à enrichir leur vocabulaire. Dans les ateliers d’écriture poétique avec les adolescents, j’insiste pour qu’ils élargissent leur lexique de la vie quotidienne à d’autres mots… qui sont dans les livres, dans les dictionnaires.
La poésie classique était d’approche plus difficile. Le poème libre ou en prose est plus aisé à appréhender et composer. L’écriture poétique initiatrice des jeunes collégiens se limitait à deux strophes en une heure. Relever ce défi donne une grande joie et une émotion que les jeunes partagent dans la lecture et l’écoute des strophes composées. Et ils en parlent avec bonheur autour d’eux.
Dans vos écrits, on sent une volonté constante de raconter ce qui ne figure pas dans les manuels : les voix mineures, les détails oubliés, les histoires orales. Est-ce là, selon vous, le rôle politique de l’écrivain ?
Cela tient essentiellement au drame humanitaire vécu par les victimes humbles et en majorité analphabètes que je défends. Il s’agit des Marocains expulsés d’Algérie en 1975. Ce sont nos grands-parents et parents, travailleurs acharnés qui avaient peu accès à la parole publique. Ce sont les oubliés de l’histoire, des taiseux ou des voix mineures comme vous le dites.
Ce sont des pauvres gens loyaux et dignes qui méritent, plus que jamais, respect et justice. Leur donner la parole à travers mes 4 livres sur le thème Ecrits de l’exode et de la mémoire (1975-2025) est une sorte d’hommage à leur dignité d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont été spoliés de leurs biens et de leurs vies enracinées en Algérie depuis des lustres et des générations.
C’est une population de l’oralité, de la parole donnée et tenue. Ce sont ces hommes d’honneur qui ont aussi donné leur vie pour l’indépendance de l’Algérie et qui se retrouvent expulsés manu militari de la terre qui a recueilli le sang et les dépouilles des martyrs marocains.
La littérature vous jette dans la bataille, soulignait Jean-Paul Sartre.
Alors oui ce travail mémoriel, d’écriture et de témoignage et donc d’engagement pour une cause est assumé par l’écrivain. Le rôle politique est de dire non à la violence d’Etat, à l’injustice, à la barbarie et l’obscurantisme. Autant d’horreurs et d’ignominies qu’il faut dénoncer et bannir pour les générations futures. Passeur de mémoire est un rôle éminemment politique pour l’écrivain-témoin de son temps. Un rôle d’éducateur pour la promotion d’une culture des droits de l’homme et des libertés, essentiels à un environnement de paix.
On ne peut rester indifférent à un tel drame humanitaire qui a concerné environ 300 000 personnes, un nombre équivalent à celui des Marocains engagés dans la glorieuse et pacifique Marche verte.
« L’indifférence c’est la lâcheté, non la vie. L’indifférence est le poids mort de l’histoire », disait le philosophe Antonio Gramsci.
Vous dialoguez souvent avec les jeunes lors d’ateliers ou de rencontres. Qu’est ce qui, à votre surprise, les touche encore dans la littérature marocaine contemporaine ?
Les ateliers d’écriture poétique que j’anime avec des collégiens ou de jeunes étudiants d’origine marocaine en France sont l’occasion de dialogue autour de la littérature au Maghreb. Il faut souligner que mon échantillon d’appréciation est peu signifiant et ne se limite qu’à quelques traits singuliers. Le peu de connaissance de la littérature marocaine est manifeste.
L’intérêt est surtout centré sur la reconnaissance obtenue par les auteures et romancières marocaines en France. Leur visibilité télévisuelle est vécue comme une fierté « nationale ». Certains thèmes abordés sont jugés modernes et prometteurs comme l’émancipation féminine, les droits des femmes, leur visibilité publique, culturelle, artistique et politique.
La stigmatisation, les problèmes d’identité et le vécu comparé de la condition féminine des deux côtés de la méditerranée sont relativement sensibles et intéressent les jeunes.
Les genres littéraires sont relativement ignorés à l’exception de certains romans primés, biographies ou récits de vie. Un intérêt récurrent concerne ces derniers quand ils sont en particulier portés à l’écran. C’est sans doute l’effet série ou Netflix. Les jeunes ont une culture artistique nomade et fragile, liée aux performances des artistes de tous continents présents et visibles sur les médias et les réseaux sociaux. L’intérêt pour la littérature reste plus volatile.
Croyez-vous que la mémoire marocaine - plurielle, parfois douloureuse - est assez transmise par le biais du livre ? Ou est-elle condamnée à vivre dans les silences familiaux ?
Je pense que le livre recèle un potentiel infini de transmission de la mémoire et des mémoires. Dans les divers genres littéraires se retrouvent des fragments de mémoire plurielle qu’ils soient heureux ou plus douloureux. La transmission présente un effet de résilience, et un travail de deuil essentiels quand la mémoire est déchirée et déchirante. Le livre en lui-même est un devoir de mémoire, socioculturel, politique et historique.
Il est, bien entendu, des aspects intimes ou privés de la mémoire qui doivent demeurer, par pudeur ou douleur impartageable, dans le domaine familial. Ce n’est pas une condamnation au silence mais une autre manière plus intime de vivre des parts de mémoire qui n’ont pas besoin d’écho social.
Comment créer un lien de lecture entre un adolescent de banlieue française et un recueil de poésie amazighe ou une saga d’immigration racontée en arabe ? Est-ce un défi de langue ou un défi d’imaginaire ?
Il y a aura nécessaire un défi linguistique d’abord, me semble-t-il, lié à la plus ou moins grande familiarité soit avec la langue amazighe ou arabe. J’avoue que pour moi-même, le trajet ou la distance migratoire a gommé une certaine connaissance des traits fins de la langue et de la culture d’origine (l’arabe en l’occurrence), qui ont évolué dans l’espace-temps de l’absence.
La langue est liée à un imaginaire. L’imaginaire se greffe à la langue. Le défi linguistique et ses contraintes morphologiques, sémantiques, stylistiques se trouvent faciliter par l’imaginaire qui n’a pas de contraintes intrinsèques. L’imaginaire s’affranchit aisément du carcan de la langue. C’est un cheval fou de la pampa de l’imagination. Avec un jeune fougueux de banlieue européenne, ils peuvent trouver un terrain d’entente créative.
Si vous prenez les sagas audiovisuelles, nous avons toujours les recours possibles aux traductions. Puis la nouveauté pour la jeunesse est qu’elle parle plusieurs langues et les hybride dans un imaginaire qui peut nous surprendre, nous les vieux plus habitués ou soucieux d’un formalisme plus académique et, sans nul doute, désuet à leurs yeux.
Si vous deviez laisser un seul vers, une seule phrase ou un seul paragraphe à une génération future d’enfants marocains, qu’écririez-vous pour qu’ils aient envie, eux aussi, de devenir des passeurs de mémoire ?
Je resterai dans le champ de la poésie. Je reprendrais des mots, des phrases, des cris et des fragments de chansons de Léo Ferré qui sont des pépites poétiques. Que j’agrémente de la verve poétique palestinienne et marocaine.
« A l’école de la poésie, on n’apprend pas, on se bat. »
« Inscris…Je suis arabe » Mahmoud Darwich.
« Tant que je lis et j’écris, j’existe » d’Edmond Amran El Maleh.
« Ecris la vie. » Abdellatif Laâbi.
« La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique ».
Les jeunes générations seront ainsi passeurs de mémoire culturelle et artistique avec les armes pacifiques de la poésie de combat pour une humanité plus éthique. Et que colorent l’amour partagé du chant du monde et de la musique de la mer.
Un mot sur l’auteur Hachemi SALHI
Hachemi SALHI, né en 1952 à Oran (Algérie), est sociologue, auteur et poète. Ancien membre du Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) du Nord-Pas de Calais, il a présidé la Fédération Laïque des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) du Nord. Il est président-fondateur de l’association de soutien des Marocains expulsés d’Algérie en 1975, nommée « le devoir de mémoire 1975 ».
Il a écrit trois recueils poétiques :
- L’Arganier, un jour le dira au saule pleureur
- Pièces poétiques sans provision
- Le Rameau d’or du caroubier
Sous le thème Écrits de l’exode et de la mémoire (1975-2025), il a publié
- Un récit La Conférence des oiseaux expulsés,
- Traduit en arabe sous le titre Mantiq al-Tayr al-Tarid,
- Un album pour la jeunesse Le P’tit Oranais Marocain. Tome 1 : Exode 1975
- Et un poème documentaire La mémoire défaite.
Avec Patrick Bonney et les Poètes en Herbe du collège Pascal de Roubaix (Hauts-de-France), il a publié, en 2023, un essai poétique intitulé « La Poésie est une Grammaire Douce ».
Avec la poétesse franco-syrienne Maram-Al-Masri, il prépare un livre intitulé « Gaza, terre immortelle d’humanité », en 4 langues (à paraître en mai 2025).
Il a écrit trois recueils poétiques :
- L’Arganier, un jour le dira au saule pleureur
- Pièces poétiques sans provision
- Le Rameau d’or du caroubier
Sous le thème Écrits de l’exode et de la mémoire (1975-2025), il a publié
- Un récit La Conférence des oiseaux expulsés,
- Traduit en arabe sous le titre Mantiq al-Tayr al-Tarid,
- Un album pour la jeunesse Le P’tit Oranais Marocain. Tome 1 : Exode 1975
- Et un poème documentaire La mémoire défaite.
Avec Patrick Bonney et les Poètes en Herbe du collège Pascal de Roubaix (Hauts-de-France), il a publié, en 2023, un essai poétique intitulé « La Poésie est une Grammaire Douce ».
Avec la poétesse franco-syrienne Maram-Al-Masri, il prépare un livre intitulé « Gaza, terre immortelle d’humanité », en 4 langues (à paraître en mai 2025).












 L'accueil
L'accueil