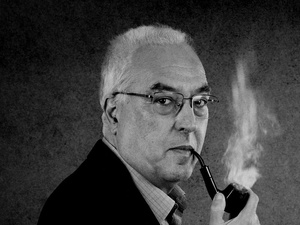Le chômage n’est pas une fatalité, mais on le traite comme un héritage
On nous parle de chômage, de croissance inclusive, d’opportunités pour la jeunesse… Et pourtant, créer de l’emploi chez nous ressemble parfois à une chasse au trésor sans carte, sans boussole, et avec un trésor qui aurait changé de place entre-temps. On a des plans, des stratégies, des PowerPoints colorés — mais sur le terrain, les jeunes continuent à guetter une embauche comme on attend le bus : sans garantie d’arrivée.
Ce n’est pourtant pas la matière grise qui manque. Le Maroc regorge d’experts, de chercheurs, de think tanks, de rapports classés confidentiels mais oubliés dans les tiroirs. Tous disent, à peu près dans toutes les langues possibles, que pour créer de l’emploi durable, il faut d’abord construire un tissu productif digne de ce nom. Pas juste bricoler des programmes de stage ou d’auto-emploi à crédit. Il faut investir sérieusement dans l’industrie locale, l’agriculture intelligente, la recherche appliquée… bref, le travail qui fait travailler.
Et là, une évidence saute aux yeux : il n’y a pas d’emplois sans vision. Et pas de vision sans écoute. Mais qui écoute ? Trop souvent, les décideurs ont les oreilles pleines de chiffres mais sourdes aux idées. On croit encore que l’emploi va tomber du ciel si on attire trois investisseurs étrangers ou qu’on vend du Maroc à la découpe dans des salons internationaux.
On espère des miracles économiques sans avoir résolu les équations simples : une école qui prépare vraiment au marché du travail, une fiscalité qui encourage la production plutôt que la rente, des infrastructures adaptées aux PME, et surtout, une confiance restaurée entre l’État et ses jeunes citoyens.
Ce qui manque, c’est moins le capital que le cap. Moins l’argent que la méthode. Moins les outils que l’envie de les utiliser autrement. Tant que la réflexion stratégique restera un hobby pour colloques fermés, et non un levier actif de politique publique, on continuera de tourner en rond. À croire que l’on préfère gérer le chômage comme une fatalité plutôt que de le combattre comme un défi.
Ce n’est pourtant pas la matière grise qui manque. Le Maroc regorge d’experts, de chercheurs, de think tanks, de rapports classés confidentiels mais oubliés dans les tiroirs. Tous disent, à peu près dans toutes les langues possibles, que pour créer de l’emploi durable, il faut d’abord construire un tissu productif digne de ce nom. Pas juste bricoler des programmes de stage ou d’auto-emploi à crédit. Il faut investir sérieusement dans l’industrie locale, l’agriculture intelligente, la recherche appliquée… bref, le travail qui fait travailler.
Et là, une évidence saute aux yeux : il n’y a pas d’emplois sans vision. Et pas de vision sans écoute. Mais qui écoute ? Trop souvent, les décideurs ont les oreilles pleines de chiffres mais sourdes aux idées. On croit encore que l’emploi va tomber du ciel si on attire trois investisseurs étrangers ou qu’on vend du Maroc à la découpe dans des salons internationaux.
On espère des miracles économiques sans avoir résolu les équations simples : une école qui prépare vraiment au marché du travail, une fiscalité qui encourage la production plutôt que la rente, des infrastructures adaptées aux PME, et surtout, une confiance restaurée entre l’État et ses jeunes citoyens.
Ce qui manque, c’est moins le capital que le cap. Moins l’argent que la méthode. Moins les outils que l’envie de les utiliser autrement. Tant que la réflexion stratégique restera un hobby pour colloques fermés, et non un levier actif de politique publique, on continuera de tourner en rond. À croire que l’on préfère gérer le chômage comme une fatalité plutôt que de le combattre comme un défi.
Et si on écoutait les laboratoires d’idées ?
Dans plusieurs pays émergents, les politiques d’emploi s’appuient sur des think tanks qui testent des solutions avant de les appliquer : formation en alternance, économie verte, crédit ciblé pour l’innovation locale… Au Maroc, ces idées existent, mais peinent à sortir du monde universitaire. Entre les diagnostics lucides et les politiques publiques, il y a un gouffre. Et il serait peut-être temps d’en faire un pont, pas un oubli.












 L'accueil
L'accueil